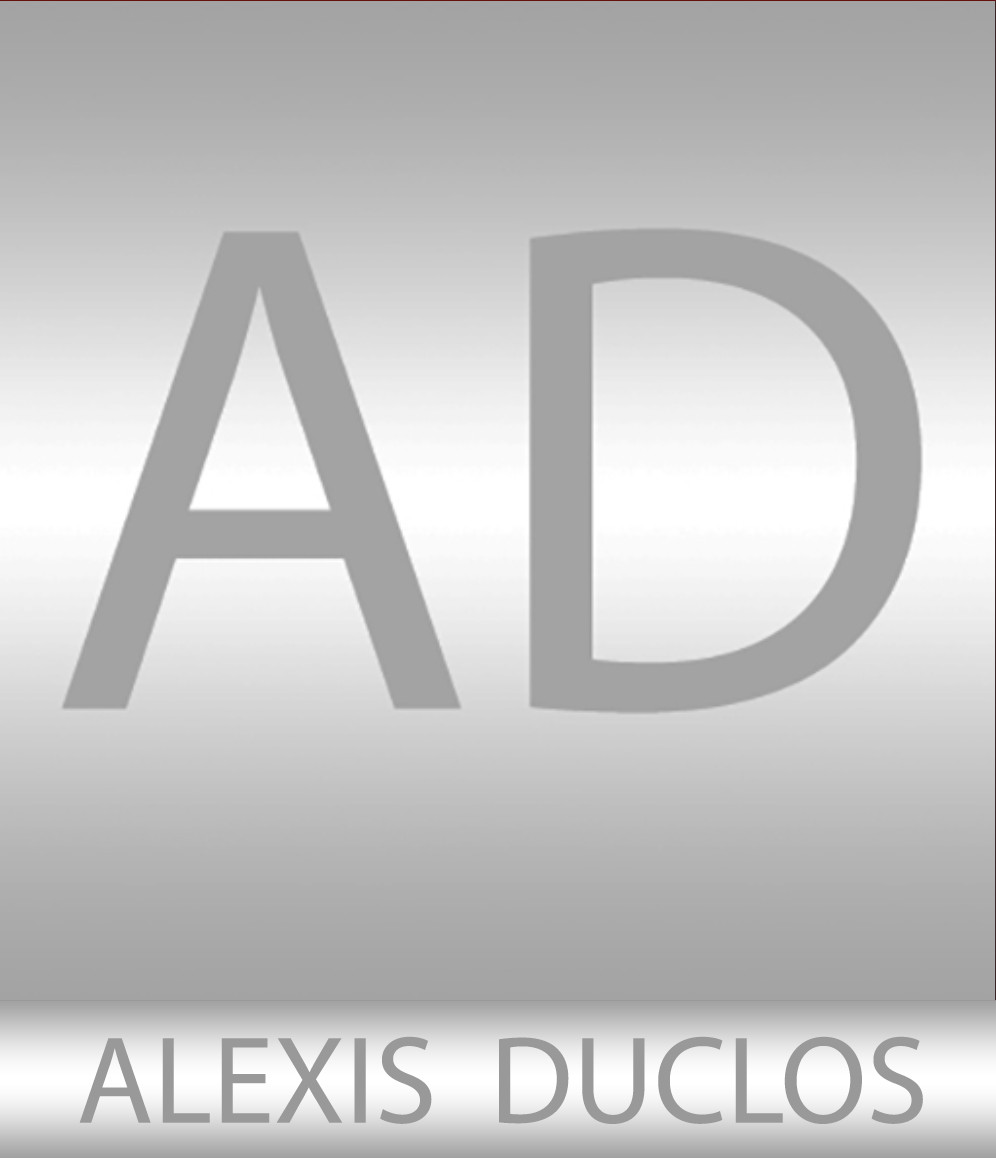Alors c’est la panne d’air. Perdu sous la glace, je ne respire plus. Je décide de jouer les secondes qu’il me reste à vivre.



Le pilote baragouine dans son micro tandis que la turbine de l’Ecureuil AS 350 B3 donne toute sa puissance. J’attache ma ceinture de sécurité et cale mes appareils-photos entre mes jambes. Depuis la commune de Bessans, l’hélicoptère s’arrache du sol, se cabre doucement pour se glisser dans la vallée du Ribon. Une escorte de pins cembro m’accompagne, chandeliers étranges qui étirent leurs hautes branches vers le ciel. Nous nous dirigeons vers le glacier de Rochemelon, à 3.538 mètres. Jeudi 25 septembre 2003, c ’est le début de l’automne, je suis en reportage photographique pour l’agence Gamma.
L’hélicoptère s’élève en direction de la haute montagne. J’ai encore le temps de vérifier mon matériel qui comprend un caisson étanche « Sea and Sea », un boîtier Canon, un 35 mm (f 2.8), un 50 mm (f 1.4) et un grand angle 16 mm (f 3.5). A gauche, le pic de Rochemelon et au centre, ce fameux lac qui a la forme d’une amphore romaine dont l’extrémité flirte avec le vide. Il s’agit d’un lac épiglacial, de 600 mètres de long sur 80 mètres de large. C’est le sujet de mon reportage : des millions de tonnes d’eau qui peuvent à tout moment se déverser sur une pente abrupte ouverte sur les villages de l’Italie toute proche. A cette heure du jour, la lumière est orange. Elle semble réconforter les monts devenus presque roses. Plus haut dans le ciel, les nuages laissent entrevoir un avion à réaction qui trace une ligne de craie blanche sur un tableau bleu. En contrebas, l’ ombre froide balafre un sentier noir qui va se perdre en forêt. C’est la lumière de la fin du jour, celle qui accompagne les êtres vers le crépuscule d’un lendemain.
L’hélicoptère se pose délicatement sur le manteau blanc. Pour les photos, une plongée sous le lac est indispensable. Le vent fait rebondir la neige. Le soleil est sur le déclin. Les conditions sont difficiles car le lac est recouvert d’une épaisse couche de glace. C’est bientôt la fin du jour, le temps presse. Je m’inquiète. Pour ouvrir la voix d’accès et de sortie de plongée, Philippe, capitaine de pompier, est la personne responsable de la mission. Il perce un large trou sur le bord de la rive puis se glisse doucement sous la chape blanche. Il emporte avec lui la ligne de vie. Il s’agit d’un bout fixé à l’aide d’un mousqueton sur le harnais du plongeur qui doit le tendre tout au long de la plongée. Pourtant la ligne de vie n’est pas tendue et point de harnais. L’eau est trouble et noire, la visibilité quasiment nulle. Moi qui rêvais d’un univers magique, baigné d’une lumière cristalline ! Malgré la situation risquée et le peu de visibilité, la décision est prise d’effectuer la plongée. Le reportage doit se faire de l’autre côté de la rive, à environ cinquante mètres du point de départ, dans la zone d’exploration décidée par le capitaine. Mon travail consiste à photographier les plongeurs effectuant les relevés des parois du lac. Etant donné les conditions, la prise de vue se fera près de la surface. Je veux pouvoir composer mon cadrage avec une moitié d’image où l’on voit la rive glacée du lac à l’air libre puis l’autre moitié sous la surface, et ainsi voir les plongeurs. Je m’équipe de ma combinaison étanche, la leste de 9 kg de plomb en prévision d’une plongée sous une glace épaisse, solide, incassable. Il faut respirer calmement pour minimiser les risques de givrage du matériel. Mon binôme, Alain, est pompier et plongeur confirmé. C’est rassurant. Il me fournit un compas qui m’indique 170 degrés, cap à suivre pour rejoindre la rive. Pour pouvoir communiquer car il y a peu de visibilité, il est convenu de ne pas utiliser les signes classiques de la plongée sous-marine mais plutôt de se toucher les épaules en cas de problème. J’enfile mes palmes, vérifie mon matériel et mon équipement. Derniers rayons de soleil, la neige est grise, le froid m’envahit. Comme moi, la nature se recroqueville. Je me glisse doucement sous la prison de glace dans une eau sombre et sale. Je progresse jusqu’à ne plus avoir pied, je flotte doucement sans même m’en rendre compte. Mon équipier est sur ma gauche. Nous avançons lentement juste sous la glace. Dans la main gauche, j’agrippe la ligne de vie. Pas de mousquetons, c’est la consigne… La ligne de vie est devenue une ficelle flottant mollement dans les éléments. Je quitte le monde de la lumière et de l’air libre pour pénétrer dans une obscurité glaciale. Se contrôler pour rester maître de soi. Je pense à ma bouteille, à ce petit tuyau de caoutchouc qui me procure l’air que je respire. Ma vision elle aussi a changé. Il ne s’agit plus de la haute montagne, de ses grands espaces, de son air pur.
A présent, tout est noir, hormis le faisceau de lumière blafarde provenant de la torche fixée sur mon casque. La lumière éclaire les milliards de particules en suspension ; cela en devient presque aveuglant. Nous avançons doucement, en respirant calmement. Pourtant je sens le stress monter en moi. Il n’est plus question de faire machine arrière, je progresse dans le noir. Je ne vois plus mon binôme, c’est normal, le plafond de glace est maintenant recouvert de neige. Nous sommes presque au milieu du trajet à effectuer pour rejoindre le site du reportage. Je tends mon bras et me rends compte que ma main est invisible. Il fait nuit, la lumière n’a plus les mêmes vibrations. Nous avançons graduellement dans le noir avec pour seul repère la lueur olivâtre du phare d’Alain, qui se trouve à un mètre de moi. Tellement proche de l’air libre et pourtant séquestré par l’épaisse couche de glace dont mon casque racle la surface. Je respire lentement mais pas assez. Soudain mon détendeur se met à fuser, c’est-à-dire qu’il m’envoie de l’air en permanence ; l’air qui passe dans le tuyau va se mettre à geler dans les prochaines secondes. Je me retourne vers Alain, m’approche pour lui montrer le problème technique. Je lui touche son épaule pour bien lui signifier que je vais bientôt ne plus avoir d’air. Alors dans un geste mal contrôlé, il m’arrache mon masque. L’eau glacée me saisit le visage. Je ne vois absolument plus rien, tout juste des visions de bulles avec le bruit strident qui les accompagne. Ne pas paniquer, ne pas paniquer. J’entr’aperçois un autre embout que me tend mon coéquipier. Je le saisis rapidement mais lui aussi se met à fuser. Dans cette manœuvre précipitée, je constate que lui et moi avons perdu la ligne de vie. Nous sommes perdus sous la glace, l’eau est noire, je suis désespérément seul. Surtout ne pas paniquer. Que faire ? Je sais qu’il est impossible de percer la glace. Alors immédiatement je comprends le déterminisme d’une situation menant à la mort. Ma mort.
Quel cheminement pour rester lucide ? Quelle décision prendre ? Quels moyens pour m’en sortir ? Je pense m’accrocher à Alain pour lui confier ma vie, et donc me noyer à ses côtés. Pompier, il pourra ensuite me réanimer sur la berge. Mais combien de temps mettra-t-il pour me sortir de là ? Puisque lui aussi est perdu. J’écarte vite cette option, il y a trop d’inconnues. Il faut réfléchir vite, même si le temps m’impose une autre échelle, une autre densité, un autre rythme. Maintenant, je respire de la glace en débit continu. Mes dents me font souffrir, mes gencives sont brûlées par la violence du froid. Consulter mon compas m’est impossible puisque je n’ai plus de masque. La douleur devient insoutenable. Je réalise que mon détendeur ne détend plus rien, je ne peux plus respirer. C’est la panne d’air. Perdu sous la glace, je ne respire plus. A cet instant précis, je décide de jouer les secondes qu’il me reste à vivre…
Je tente de nager dans une direction qui peut-être sera celle de la berge ; ou peut-être pas. Sur le dos, je palme, je palme, et je palme encore, mais je suis fortement lesté, trop lesté. Je dépense toute mon énergie. Je n’ai plus d’air. Je continue de palmer tout en tapant avec mon poing cette glace prison qui ne veut pas céder. Et si je me suis trompé de direction ? Je doute. J’ai peur de mourir. Ma tête heurte à plusieurs reprises la glace ; au fur et à mesure de ma progression, la lumière change pour devenir plus franche et finalement plus éclatante. Même si je n’ai plus de masque, la vision est belle, je vois une étoile éclatante juste derrière la glace translucide : le soleil. Souvenir d’enfance où mes yeux mi-clos jouaient derrière une vitre gelée inondée par une lumière en contre-jour. Dernières molécules d’air dans mes poumons pour une ultime vision, belle et rassurante, avant le néant. Mais aussi, dernière lutte farouche contre les muscles de ma bouche qui veut s’ouvrir pour respirer. Surtout ne pas ouvrir la bouche. Surtout ne pas ouvrir la bouche. Chaque millième, chaque centième, puis chaque dixième de seconde me signifie que le temps s’est réapproprié ses dimensions. Il s’écoule à pleine vitesse mais mon cerveau le décortique, le triture pour créer un ralenti. Il faut se rendre à l’évidence, il s’agit bien de la dernière souffrance d’un combat perdu d’avance car je n’ai plus le choix. Je suis prêt, je n’ai plus peur de mourir. Ma bouche va s’ouvrir. Mais non je ne veux pas. Je ne peux pas. Je pense à la vie. Je pense à ma femme, à mon fils âgé de 10 ans, avec qui il me reste des milliards de choses à faire. J’enrage de m’être trompé. Je palme de moins en moins, de plus en plus lentement. C’est la fin, je ne vois plus rien ; sans doute le « voile noir » et puis après, ce sera la noyade avant le silence. C’est terminé, le voyage de ma vie s’arrête sous le lac de Rochemelon, par une belle journée d’automne.
Tout à coup, comme une balle explose une vitre blindée, mon poing, mon bras et enfin mon corps perforent la couche de glace. Ma bouche s’ouvre enfin ! Respirer ! Respirer ! Je peux enfin respirer et même aspirer ce gaz tant espéré, presque oublié : L’AIR. Enivré, j’ai l’étrange sensation d’être entre deux mondes. Celui de ma mort, acceptée voici quelques secondes et celui beaucoup plus improbable, d’un retour à la vie. Les choses matérielles m’apparaissent sans aucune importance. En revanche, je ressens la permanence de cette architecture incalculable : l’immensité de la nature. La montagne s’emmitoufle dans un ciel démesurément bleu et laisse glisser son ombre noire jusqu’au lac. Je reste planté là, groggy par ce tourbillon d’images et de lumières, désorienté par la renaissance de mon corps, de mon esprit, de cette vie, la mienne, particule minuscule faisant partie de l’univers. Quelques minutes plus tard, dans la lueur rasante de la fin du jour, maquillée par l’ombre grise d’une congère, j’aperçois une main tremblante gantée de noir percer la glace. C’est mon équipier, dix mètres plus au nord.
ALEXIS DUCLOS